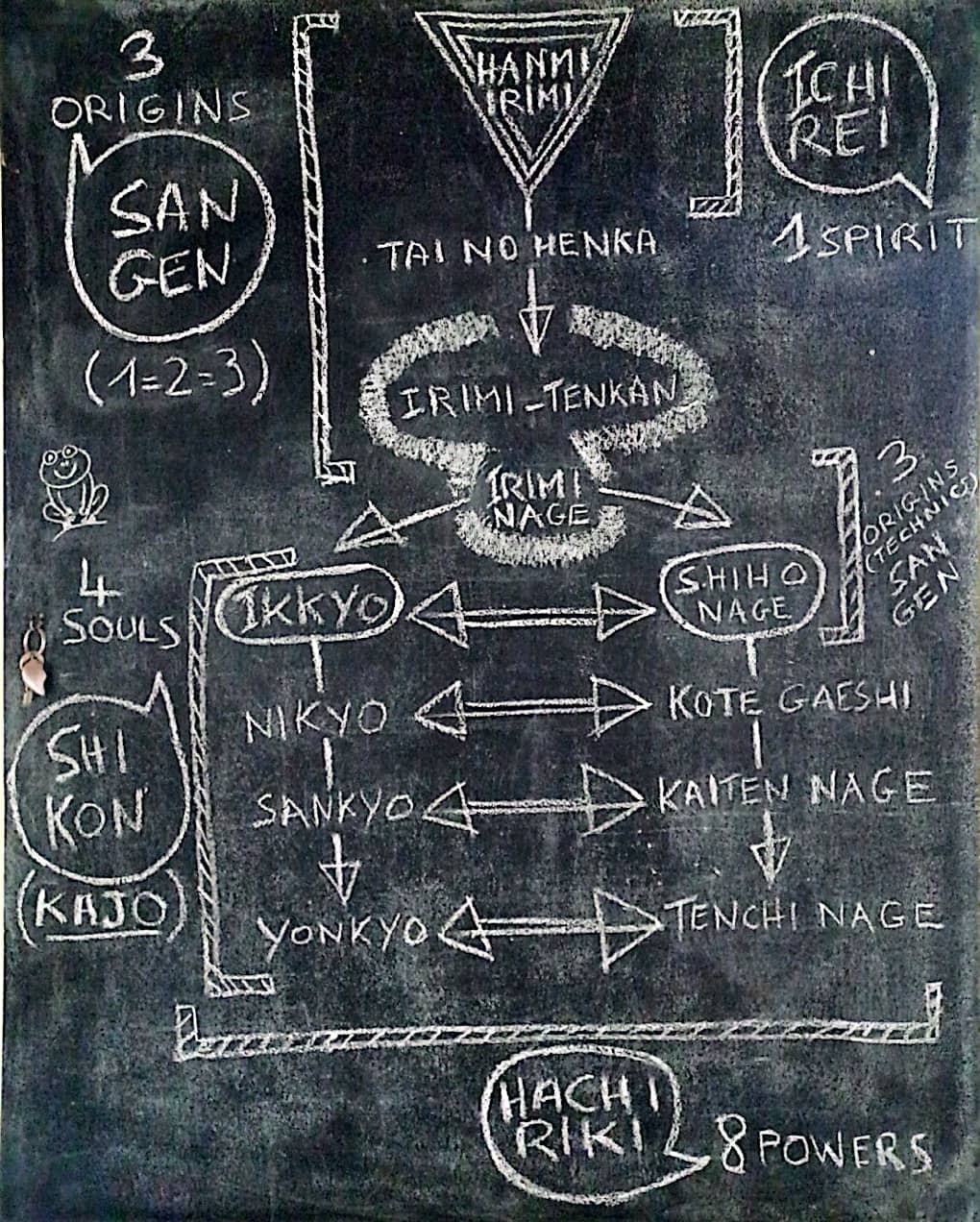Ce qui a manqué jusque à présent pour que réussisse l’Aikido est de même nature que ce qui a manqué pour que réussisse la Renaissance. Dans les deux cas l’impulsion était là, mais nous nous sommes égarés, la diritta via era smarrita.
Il faut d’abord se débarrasser de l’idée que la Renaissance corresponde à une période historique précise. Elle ne commence pas avec Pétrarque, et elle ne finit pas avec Descartes. Ce n’est pas un évènement, c’est un mouvement, un courant venu des profondeurs de l’esprit européen, dont les racines plongent dans le Moyen Âge lui-même - qui pour cette raison n’est peut-être pas un âge aussi sombre qu’on a pu le dire - et qui ne s’arrête pas non plus à la porte de la modernité.
La Renaissance, ce sont avant tout des hommes qui ont en commun un même élan, une même force vitale, que Machiavel appelle virtù, Nietzsche die große Gesundheit, la grande santé, et qui exprime dans l’art, dans la politique et dans la vie sociale, une forme de démesure, de débordement d’énergie, de vivacité et de souplesse, voire de témérité et de férocité. Si le regard ne plonge pas à la profondeur d’où elle a surgi, on ne voit de la Renaissance que l’écume des choses, les détails de l’histoire et de l’art.
Dieu, immuable, est défini par sa pérennité, tout mouvement l’éloignerait en effet de la perfection où il demeure pour l’éternité. La marque de l’homme est au contraire l’évanescence et la transformation. Vivre c’est changer, l’être humain est libre de ses métamorphoses parce que sa forme définitive n’est pas fixée, il déploie dans ce mouvement, et dans le bref temps de son existence, son inventivité et sa créativité, y trouve sa dignité et sa joie de vivre. Montaigne, qui fut un grand Renaissant, ne situe pas ailleurs que dans cette perpétuelle capacité de changement, la valeur de l’existence humaine. C’est en ce sens qu’il déclare que "tout homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition", la forme ne désignant pas ici un quelconque archétype figé de l’humanité, mais précisément cette faculté permanente de transformation qui est le propre de l’homme par opposition à Dieu. L’art parle de cela.
Parce qu’imparfaite, la nature humaine est donc labile, mais son imperfection l’empêche de créer de manière féconde dans les divers domaines de la civilisation si n’est pas canalisée l’énergie débordante qui la caractérise, et qui, faute d’être domptée, nourrit les passions extrêmes. Aut caesar aut nihil, le caractère formidable mais cruel et stérile de César Borgia est un exemple renaissant du déchaînement d’une vitalité ainsi débridée.
Or il se trouve que ce n’est pas la voie de l’éducation des forces vives de transformation de l’humanité qui fut choisie au cours des deux derniers millénaires, c’est celle de leur éradication. La religion, et notamment le christianisme, ont en effet encouragé l’homme à plébisciter ce qui demeure, à se conformer au modèle définitif de l’union à un Dieu parfait, immobile au cœur du monde, garant d’une vérité intangible. Cet objectif n’étant réalisable qu’au sacrifice du mouvement multiforme de la vie, de tout ce qui passe, change et se métamorphose, la conséquence de ce choix fut logiquement le rejet du corps, de la sensualité, et d’une manière générale de tous les attributs de la vie terrestre, considérés comme des obstacles à l’accomplissement de l’homme dans son avenir post mortem. Les lendemains qui chantent… dans un autre monde.
Le Moyen Âge européen fut pénétré de cette détestation de l’impermanence. L’aversion pour les conditions de la vie imposées par la nature conduisit à leur désaffection, on leur préféra la promesse d’un au-delà stable et rassurant. L’effacement du corps humain dans les peintures et les sculptures médiévales, doit être compris comme la conséquence de cette disposition d’esprit critique, qui choisit de censurer la nature au nom de l’idéal d’éternité. Le corps a péché, il est honteux, il est donc méprisé et négligé au point d’en devenir difforme :

Le raisonnement est à peu près celui-ci : puisque le corps disparaît de manière évidente avec la mort, seule l’anima, l’âme, a une chance de trouver sa place dans l’éternité auprès de Dieu, oublions donc le corps et occupons-nous de l’esprit, et désapprenons d’autant plus le corps que les préoccupations de ce dernier viennent en concurrence et en perturbation de celles de l’esprit, et nous en éloignent.
On verra à juste titre dans une certaine boulimie laïque de connaissances, causée par l’hypertrophie de la force intellectuelle, un avatar moderne de cet arbitrage moyenâgeux. Or savoir et compréhension ne doivent pas être confondus, la compréhension n’est pas une somme de savoir, c’est une modification de l’être, qui intervient seulement quand la force du savoir est fécondée par les forces du sentiment et de la sensation : la compréhension est une transformation, et c’est dans cette mesure qu’elle appartient au registre de la vie.
Il suffit de comparer l’étrange absence du corps dans les œuvres médiévales, aux préoccupations exactement inverses, à l’intérêt pour la nature, à l’attachement à la réalité, qui émanent des Carnets de Léonard de Vinci par exemple, ou bien du David de Michel-Ange, pour comprendre ce contre quoi la Renaissance s’est élevée:


C’est dans les abysses que s’affrontent cachalots et calamars géants, les luttes de ces titans des mers y sont invisibles pour nous. De même est cachée à nos yeux la guerre qui oppose depuis trente siècles deux forces souterraines de l’humanité : l’une œuvrant à la condamnation et à l’abolition du corps, l’autre à sa célébration - et pour cette raison à la transfiguration de toutes les valeurs nées de l’hostilité à la vie. Les deux camps possèdent leur héros. A la fuite dans l’idéalisme et dans la morale de Platon, de Saint Augustin, des Pères de l’Eglise, au dogme d’une vie désirable après la mort seulement, la Renaissance opposa l’ici-bas : le soin et l’éloquence du corps d’un Rabelais, d’un Raphaël et d’un Michel-Ange, l’indépendance d’esprit et l’attachement à la réalité d’un Léonard de Vinci, d’un Machiavel, d’un Shakespeare et d’un Montaigne.
La Réforme fut la grande bataille perdue par la Renaissance, elle l’empêcha de mener à terme la transvaluation, le renversement de toutes les valeurs enfantées par l’idée contre nature de permanence. En face des forces qui exaltaient à nouveau les valeurs de changement et de transformation, les valeurs primordiale de la vie, le goût de la première Antiquité pour la vie, surgit Luther qui rétablit l’Eglise. A l’aube des temps modernes, le courant ainsi ressuscité par le prêtre allemand aboutit à Descartes, puis à Kant, à la préséance de la raison sur la sensation, sur les inclinations et les instincts, à l’homme duel. Le courant porté par la Renaissance mena lui au type d’homme opposé, chez qui la raison, la sensibilité, le sentiment, la volonté et le corps ne sont pas dissociés au nom d’un idéal despotique : à Goethe, qui incarne au contraire l’amour de la nature, la vitalité d’instincts puissants mais dominés au profit de la création, et des passions disciplinées au service d’une œuvre. Goethe est un remède au mal de vivre et à l’arbitraire.
Quel rapport, dira-t-on, l’Aikido peut-il bien entretenir avec tout cela ?
S’il fallait répondre en deux mots, je dirais la conscience, mais je vais essayer de développer un peu.
A la lumière de ce qui a été dit jusqu’ici, il semble bien que les modalités de notre existence soient en rapport avec l’interprétation que nous avons du réel, et notre manière de le prendre en compte. Alors vient la réflexion suivante : pour élucider avec probité et avec courage la réalité - souvent douloureuse - telle qu’elle est, c’est-à-dire sans chercher à la travestir, peut-on choisir une forme plus extrême de cette réalité que celle du champ de bataille, celle du combat à mort ? Existe-t-il une manière plus intense et plus décisive d’affronter sans les fuir les problèmes posés par la réalité, que celle qui met inévitablement en jeu la vie elle-même ? Et n’est-ce pas sur le fil de la vie et de la mort que se juge le mieux la faculté d’adaptation au réel ?
C’est justement cela que propose l’Aikido : mettre l’homme - le corps même de l’homme - dans une position telle que ce corps n’ait d’autre choix pour se maintenir, pour continuer d’être, que de découvrir les lois physiques qui lui permettent d’utiliser la précarité de sa situation comme source de sa métamorphose, métamorphose physique évidemment, mais spirituelle aussi dans la mesure où le corps enseigne à l’esprit. Vivre c’est changer, c’est donc prendre des risques, ce n’est pas "prendre soin de ne se blesser à aucune pierre du chemin". Faire face au réel, quand il se présente sous son jour le plus épouvantable et le plus dangereux, interdit de le falsifier. Les marins savent cela, "Je suis au cœur du typhon, il n’y a plus de ciel, il n’y a plus de mer !"… sont les dernières paroles d’Alain Colas, et on croit Kersauson quand il écrit que la mer est monstrueuse, parce qu’il y a survécu. Or l’instinct, s’il est nécessaire, n’est pas suffisant dans les situations extrêmes, il faut aussi que l’ardeur de la force vitale soit contrôlée et régulée par la forme. C’est de l’équilibre entre l’animalité de la nature humaine et la puissance organisatrice de la forme que naît le mouvement d’Aikido, tout comme l’équilibre de l’art grec dépendait de l’harmonie entre la démesure dionysiaque et la tempérance d’Apollon.
La transfiguration du réel dans l’art de la Renaissance est une tentative de retour à cet équilibre, à cette harmonie par l’union de forces conflictuelles mais complémentaires, et c’est la définition même de la virtù. Cette confrontation n’est pas payée chez Machiavel au prix de l’accablement, de l’amertume ou de l’affliction qui résulteraient de la vision angoissante d’un monde désespérant de dureté, elle est joyeuse : c’est avec entrain et bonne humeur que "Le Prince" parle de l’impitoyable réalité. Et c’est dans le même esprit que le Fondateur de l’Aikido, Morihei Ueshiba, explique qu’il faut pratiquer dans la joie. La joie est une force majeure dans l’acquiescement au réel, comme l’a vu Clément Rosset dont je fus élève à une époque où je ne comprenais rien bien sûr à ce débat. La joie est la grande force capable de s’opposer à l’idéalisme.
L’esprit qui a présidé à l’avènement de l’Aikido au vingtième siècle est le même qui a tenté de ranimer, par le souffle de la Renaissance, l’antique et primordiale approbation au réel, un réel qui est la matière même de la création, qui n’est pas source d’effroi, et encore moins prétexte à culpabilité. Devant le réel l’homme n’est coupable de rien, sa seule faute est de ne pas l’accepter tel qu’il est. La Renaissance, et l’Aikido avec ses moyens, sont apparus dans l’histoire comme des manifestations de la force en charge de restaurer l’ordre des choses.
L’un comme l’autre n’y sont pas parvenus à ce jour. Mais on sait depuis Dante que l’humanité ne progresse pas en ligne droite, la diritta via n’est pas perdue par accident, mais par définition, ce qui semble acquis doit se perdre un temps pour revenir ensuite. Pour ce qui concerne l’Aikido, l’évolution de ces dernières décennies montre que le réel y a été occulté, qu’il a cessé d’être pris en compte. Le mouvement d’Aikido est désormais décidé sans considération pour la réalité martiale, il est conditionné par l’esthétique, par les idées particulières que les uns ou les autres se font de cet art, l’Aikido est devenu un idéalisme, au même titre que la théorie des formes de Platon ou que l’éthique de Saint Augustin. Et c’est en bonne logique qu’il rencontre un certain succès dans un monde moderne lui-même en rupture profonde avec le réel. Je pense ici à la remarque de Camille à laquelle j’ai répondu sur ce site : l’Aikido comme "développement personnel, voire comme religion"… Non Camille, non, c’est le contraire exactement : l’Aikido est un attachement à la réalité objective du monde, sans rien en lui qui soit de nature subjective, et sans rien en lui qui pousse à chercher refuge dans un monde meilleur. Je regrette que les conditions ne soient pas réunies pour que je me risque à un livre sur ce thème, je vous l’aurais dédié avec plaisir.
Il existe en France, au sein de l’université de Tours, un Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance. C’est une belle initiative culturelle des années 50, en suivre les cours est une merveilleuse idée, car la Renaissance est bien plus qu’un courant artistique, c’est un sursaut de la civilisation européenne pour retrouver un sens de l’existence qui ne soit pas appuyé sur la peur de la vie et sur son désaveu. L’Aikido vient d’une autre culture, mais la parenté de principe qu’il entretient avec la raison même de la Renaissance, fait de lui un allié dans cette tentative, ce que ne soupçonnent sans doute pas les étudiants du CESR.
Le but fondamental, commun à la Renaissance et à l’Aikido, c’est l’éveil de la conscience, ou son réveil comme on veut, sa re-naissance, c’est l’avènement d’un homme objectif, d’un homme qui ne soit plus séparé du réel par le prisme de son inconscience. Aussi longtemps que l’inconscience dirige ses actions, l’homme est prisonnier du cours des choses, car les choses arrivent de toute façon, les guerres par exemple. Mais chaque prisonnier rencontre un jour sa chance d’évasion, pourvu qu’il se soit aperçu au préalable qu’il était en prison, pourvu qu’une fois seulement il soit parvenu - en se regardant sans complaisance, et en regardant les œuvres de la civilisation dont il est si fier - à se faire horreur. C’est la première condition pour sortir du sommeil.
A Christian ꙋ, à qui je pense avec affection en terminant ces lignes.